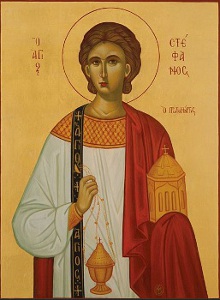Les catholiques du monde entier – de tous les fuseaux horaires – seront en communion avec le pape François, pour une heure d’adoration eucharistique, dimanche prochain, 2 juin 2013, de 17h à 18h (heure de Rome; 15h-16h, temps universel GMT).
L’évènement est une première dans l’histoire de l’Eglise, a souligné Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, qui a présenté l’événement avec Mgr José Ruiz Arenas, secrétaire du dicastère, ce mardi matin, 28 mai 2013, au Vatican.
L’adoration eucharistique aura lieu dans le monde entier en même temps, en communion avec le pape qui présidera l’adoration silencieuse de Jésus présent dans l’Eucharistie, sur l’autel de la Confession de la basilique Saint-Pierre. Le pape François priera à genoux, en silence: on ne prévoit pas d’homélie a souligné le père Federico Lombardi.
Les cathédrales seront reliées avec Saint-Pierre de Rome en mondovision ou par liaison Internet.
Communion fraternelle planétaire

L’évènement, intitulé « Un seul Seigneur, une seule foi », signifie la « profonde unité », a souligné Mgr Fisichella. L’initiative a reçu une « adhésion massive » à cette initiative, s’étendant non seulement aux cathédrales, mais aussi « aux paroisses, aux congrégations religieuses, et aux associations ».
Pour l’archevêque, cette heure d’adoration autour du sacrement « source et sommet de toute la vie de l’Eglise », une première dans l’histoire de l’Eglise, est « historique ».
« Les Iles Cook, Samoa et Honolulu s’uniront à Rome à 5h du matin, et au nord, à Reykjavik en Islande, il sera 15h », a-t-il fait observer : au Vietnam il sera 22h et en Corée minuit. En Océanie, ce sera déjà le 3 juin, entre une heure et deux heures du matin.
Que ce soit dans les Iles Galapagos ou au cœur de la forêt amazonienne, ou encore là où les catholiques sont une minorité (Norvège, Bangladesh, Irak, Burkina Faso, Russie, Japon), « tous seront synchronisés sur Rome », dans une « prière de communion fraternelle et de soutien à la foi de tous », a-t-il poursuivi.
Certains, telles les églises de Papouasie Nouvelle Guinée, Iles Salomon, participeront malgré les difficultés, qu’ils expliquent dans une lettre envoyée au dicastère : « Nos villageois n’ont pas d’électricité et il est dangereux de marcher dans l’obscurité… c’est aussi la saison des pluies et comme si cela ne suffisait pas, beaucoup de paroisses et de villages ces quatre derniers mois ont été inondés par le débordement du fleuve… ».
Même plus proche, l’évêque de Carpi, au nord de l’Italie, touché par un séisme il y a un an, écrit que « dans l’église qui remplace la cathédrale, dans les petites églises encore debout et sous toutes les tentes de fortune qui tiennent lieu de paroisses, aura lieu l’adoration ».
Cinq conférences épiscopales ont donné leur adhésion en bloc – Albanie, Belarus, Hongrie, Inde, Pérou – , d’autres diocèses ont confirmé individuellement leur participation, d’autres ont donné leur accord enthousiaste oralement: la réponse cependant n’était pas obligatoire, précise Mgr Fisichella qui annonce cependant que d’autres devraient se signaler sur leur site Internet où une carte indique les réponses.
Intentions du pape
Le pape François a communiqué les deux intentions qu’il a choisies pour cette heure de prière ; une pour l’Eglise pour qu’elle soit fidèle à la parole et à son annonce et pour le monde, notamment les plus souffrants: victimes de trafics en tous genres et malades:
1. Pour l’Eglise répandue de par le monde et rassemblée aujourd’hui en signe d’unité dans l’adoration eucharistique. Que le Seigneur la rende toujours plus obéissante à sa parole, afin qu’elle se montre au monde plus belle, sans tache ni ride, sainte et immaculée (Eph 5,28). Que par le biais d’une annonce fidèle, la Parole puisse résonner comme présage de miséricorde, et provoquer un renouveau d’engagement dans l’amour qui donne du sens à la douleur, à la souffrance, et redonne joie et sérénité.
2. Pour tous ceux qui souffrent de par le monde, victimes de nouveaux esclavages, de la guerre, de la traite des personnes, du narcotrafic et du travail forcé, pour les enfants et les femmes victimes de violences, afin que leur cri silencieux soit entendu par l’Eglise et qu’ils demeurent confiants dans le Crucifié, que l’on n’oublie pas nos frères et soeurs soumis à la violence. Pour tous ceux qui sont en état de précarité matérielle, spécialement les chômeurs, les personnes âgées et les émigrés, les sans-abri et les détenus, tous les marginaux. Que la prière et la solidarité de l’Eglise les confortent, les soutiennent dans l’espérance, leur donne la force de défendre leur dignité de personne.
Le livret de la célébration est d’ores et déjà accessible en ligne sur le site du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation et sur le site des Célébrations liturgiques pontificales. Pour le moment en italien, il sera traduit en 7 langues.
Mgr Fisichella a fait observer qu’un projet similaire avait été évoqué, sans pouvoir être concrétisé, par une religieuse italienne, la bienheureuse Elena Guerra (1835-1914), apôtre de l’Esprit Saint. Le pape Léon XIII, qui l’avait reçue en audience en 1897, l’avait approuvée.
Pour sa part, Mgr José Ruiz Arenas a expliqué les quatre caractéristiques de cet événement « historique »: profond sens de communion ecclésiale avec le pape et de l’universalité de l’Eglise; les deux intentions communes proposées par le pape pour l’Eglise et pour le monde; le schéma de la célébration déjà disponible en italien; toutes les nations n’apparaissent pas sur la carte, mais des réponses doivent encore arriver jusqu’à dimanche.
Rendez-vous de l’Année de la foi
Quant à l’Année de la foi, Mgr Fisichella a indiqué le chiffre des pèlerins venus à Rome: 4,3 millions fidèles sont venus de façon organisée, en groupes, mais il faut y ajouter les nombreuses personnes venant pour un seul jour, individuellement, à l’occasion par exemple de l’angélus du dimanche.
Les prochains rendez-vous sont: les 4-7 juin, le pèlerinage des séminaristes et novices, de ceux qui sont en chemin vocationnel; les 15-16 juin les Journées Evangile de la Vie; le 22 juin, à 17h30, le concert donné en la salle Paul VI du Vatican en présence du pape François, avec au programme la 9e symphonie de Beethoven.